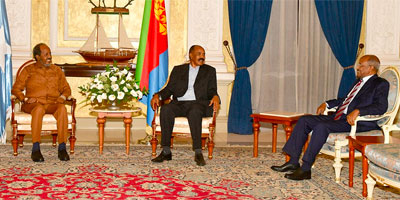Difficile de convenir d’un rendez-vous avec le ministre-globe-trotteur Mahmoud Ali Youssouf… ! La première demande d’interviewée a été formulée vers la fin de l’année 2009, c’était dans le cadre de la préparation d’un dossier spécial sur la Somalie. Mais en raison d’un agenda international extrêmement chargé du ministre, cela n’a malheureusement pas pu se faire. Les rendez-vous suivants fixés furent tous reportés à la dernière minute pour des raisons impérieuses. D’ailleurs, à peine cette interviewée a-t-elle débuté à son bureau au ministère des Affaires étrangères, qu’il était informé être attendu à l’aéroport pour l’accueil officiel de nos soldats évadés des geôles érythréennes, et dont l’avion en provenance du Soudan amorçait son atterrissage… L’entretien s’est finalement poursuivi au salon d’honneur de l’aéroport à la fin de la cérémonie.
Mahmoud Ali Youssouf nous a semblé être un homme ouvert, et extrêmement courtois ! Le fait que son nom ait été celui qui a été le plus souvent cité dans le microcosme djiboutien comme hypothèse plausible pour occuper la Primature dans la foulée des dernières élections présidentielles, n’est pas le fait du hasard. Cela témoigne de la crédibilité, du sérieux, mais plus encore du grand professionnalisme qui est reconnu, à ce grand commis de l’État : ce polyglotte s’exprime parfaitement en afar, en arabe, en anglais, en français, et en somali. N’empêche, ces rumeurs ont été rapidement démenties puisque Dileita Mohamed Dileita a été reconduit sans sourciller dans ses fonctions, l’expérience accumulée par près de dix années à la Primature et la grande habilité politique qui en découle, sont de riches atouts, au delà des liens de confiance qui l’unissent au chef de l’État. Mais nul doute que Mahmoud Ali Youssouf, est une pièce maîtresse du gouvernement : sa large connaissance des affaires du monde, ses réseaux d’amitié et de confiance avec les acteurs politiques à travers le globe, sa capacité à faire entendre la voix de Djibouti dans les instances internationales en font un homme précieux, au service du développement de notre pays.
M. le Ministre que pourriez-vous nous dire sur la situation qui prévaut à Ras Doumeira ? On a beaucoup parlé d’une médiation qatari pour trouver une issue favorable à ce contentieux frontalier, qu’en est-il ? Enfin alors que le gouvernement érythréen a toujours affirmé ne pas détenir de prisonniers de guerre djiboutiens, deux d’entre eux se sont enfuis de leurs geôles érythréennes et ont été accueillis par un parterre d’officiels, ce matin même, à leur arrivée à l’aéroport de Djibouti, aussi que compte entreprendre le gouvernement à la suite de ces derniers événements ?

D’abord je voudrais saluer le courage et l’abnégation de ces deux soldats Djiboutiens qui ont servi sous les drapeaux. Ils ont passé trois ans dans les geôles érythréennes, ils ont su s’en échapper et tout le mérite leur en revient : ils ont effectué une traversée de onze jours dans le désert pour retrouver enfin leur liberté.
Cela étant dit, je tiens à rappeler que nous sommes toujours sans nouvelle des dix-sept autres personnes, officiers et sous-officiers, qui sont absents à l’appel. La République de Djibouti, a depuis l’acceptation de la médiation qatari, transmis un dossier complet sur ces soldats prisonniers de guerre, nous avons donné toutes les informations détaillées les concernant au Qatar. Afin que ce pays puisse approcher l’Érythrée et demander des comptes. Jusqu’à ce jour l’Érythrée avait toujours nié détenir des prisonniers de guerre djiboutiens. Aujourd’hui nous détenons la preuve matérielle qui nous faisait défaut, pour prouver que ce pays détient les nôtres. Depuis un an, nous avons accepté de nous engager pleinement dans cette médiation. Nous avons également reçu des propositions concrètes pour le tracé de la frontière que nous sommes en train d’étudier. Le président de la République, lors de sa participation à la 66e session des Nations unies, à New York, a pu avoir des entretiens avec l’émir du Qatar, et a pu confirmer la bonne réception de la proposition qatarie de règlement définitif du conflit frontalier, et indiquer également l’existence de ces prisonniers de guerre dont deux viennent de s’échapper. Nous sommes en train de travailler avec le médiateur du Qatar pour récupérer les autres qui sont encore détenus par l’Érythrée.
Comment expliquez-vous la position de l’Érythrée niant l’existence de ces prisonniers ?
Je crois que l’Érythrée s’est toujours comportée de manière anormale. Nous avons toujours eu le sentiment que l’Érythrée était un État hors-la-loi. Un régime qui a tout fait pour s’isoler de la communauté internationale. Pour qu’un État décide de s’isoler, c’est que ses attitudes et ses propos sont en porte-à-faux avec l’ordre et le droit internationaux. Partant de ce constat, il ne faut pas s’étonner que ce pays là puisse adopter des attitudes incompréhensibles pour le commun des mortels et je ne parle même pas des juristes, des politiques et autres observateurs. C’est à ce type de régime que nous avons à faire, ce qui implique que nous soyons sur nos gardes et très attentifs à l’évolution de la situation. Nous nous attendons d’ailleurs à beaucoup de surprises de ce pays et de ce régime. Mais nous continuons à rester vigilants et à sensibiliser le médiateur qatari sur ces questions en suspens, que sont celles des prisonniers de guerre, des frontières, ou bien encore des infiltrations d’éléments perturbateurs armés, équipés et financés par l’Érythrée, et qui essayent de perturber le calme et la tranquillité dans le nord du pays en menant des actions terroristes, notamment en plantant des mines et des engins explosifs le long des pistes empruntées par les convois militaires et les véhicules civils des habitants des localités éloignées de ces grandes villes du Nord.
Le Qatar a t-il toujours des troupes militaires à notre frontière avec l’Érythrée ?
Oui, les observateurs militaires qataris sont toujours stationnés à Doumeira et sur l’île de Doumeira afin de veiller au respect du cessez-le-feu et au retrait des positions occupées par les forces érythréennes.
Djibouti a fait récemment un appel solennel à la solidarité internationale pour venir en aide à nos populations touchées par cette sécheresse inouïe : ne pensez-vous pas que nous nous sommes un peu précipité pour évaluer le montant de nos besoins ? Dans un premier temps ces derniers ont été estimés à 39 millions de dollars, en novembre 2010, puis à 33 millions en juillet 2011, d’ailleurs au moment où nous mettons sous presse, ce financement aurait été mobilisé. Paradoxalement dans le même temps les fonds affluent sur notre région pour lutter contre les affres de la soif dans la Corne : 1,9 milliard de dollars alloués par la Banque mondiale, 500 millions de dollars par la BAD, pour ne citer que les plus grands contributeurs ? Aussi mon questionnement est-il le suivant : l’estimation de nos besoins a t-elle été réaliste ?
Ce qui s’est passé, c’est que l’évaluation des besoins de la situation d’urgence a été faite dans le cadre d’une commission comprenant les agences du système des Nations unies, du ministère de l’Intérieur et à laquelle participait le ministère des Affaires étrangères. Cette commission d’urgence a mis en place des comités techniques qui se sont rendus dans toutes les localités du territoire afin d’effectuer sur le terrain un diagnostic précis et détaillé des difficultés de nos populations. A la suite de ces déplacements sur le terrain, un document que l’on appelle le « document consolidé » a été réalisé par les membres du comité d’urgence et les membres des comités techniques dépendant de celui-ci. Les 39 millions de dollars qui ont été arrêtés à la suite de cette évaluation ne représentent que l’assistance nécessaire pour faire face à la situation d’urgence à laquelle nous sommes confrontés. On a parlé de 39 millions de dollars parce que le système des Nations unies avait intégré sur ce montant, global, les six millions de dollars nécessaire à construction de la plateforme de réserve d’aide alimentaire du PAM pour toute la région de la Corne. Le gouvernement a demandé, lors de l’appel consolidé du 14 juillet que le système des Nations unies déduise cette somme de six millions de dollars du montant global demandé en appui à la communauté internationale, puisque cette plateforme avait une vocation régionale. Il nous paraissait compte tenu du contexte de parer au plus urgent et de nous concentrer sur nos nombreux défis nationaux. C’est ainsi que nous sommes arrivés à 33 millions de dollars. Il faut savoir qu’il s’agit de 120 000 de nos compatriotes qui sont frappés très durement par les conséquences de cette sécheresse. Bien entendu, il existe un programme plus vaste que nous sommes en train de développer, avec la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, un programme que l’on qualifie de consolidation ou de renforcement de la résilience des populations affectées par la sécheresse. Ce programme comporte un volet mobilisation des ressources hydrauliques, constructions de barrages, retenues collinaires, etc.
Il s’agit également de travailler sur un projet d’importation des eaux du fleuve Awash. Nous sommes en train de développer une étude de faisabilité dans ce sens afin d’acheminer lorsque les grandes crues et que les pluies d’été interviennent, les eaux du fleuve qui viennent s’échouer au bas de la montagne de Gamareh vers notre territoire. Le massif du Gamareh marque la frontière entre les deux pays. Avec la Banque africaine de développement (BAD) qui a tenu une réunion très importante le 15, 16 et 17 septembre à Djibouti, nous sommes en train de développer des programmes régionaux afin de renforcer et consolider la résilience de nos populations. J’ai évoqué le volet eau, mais il y a aussi un volet appui aux pasteurs nomades. Nous avons une usine de fabrication d’aliments de bétail à Douda qui n’est malheureusement plus en fonction depuis un certain temps, nous souhaitons la réactiver afin de produire de la nourriture pour notre cheptel à partir de plantes nationales ou même indigènes, tels que le prosopis, ou le laurier-rose du Yémen. Cette production permettra d’assurer la suffisance alimentaire du cheptel de nos éleveurs en période de sécheresse. Nous avons également un programme destiné, aux populations périurbaines, car vous imaginez bien que la sécheresse a accentué le phénomène de l’exode rural de nos populations. C’est ainsi que nous avons envisagé de mettre en place un mécanisme afin de faciliter la création de petites et moyennes entreprises pour ces personnes déplacées et désœuvrées. Il s’agissait avant tout pour nous de permettre à ces populations de recouvrer le plus rapidement possible une certaine autonomie financière à travers un travail, un projet qu’elles auraient elles-mêmes formulées et auxquelles l’État aurait à apporter son concours. Personne ne souhaite vivre de l’assistanat, et c’est la raison pour laquelle nous ne pouvons en faire des laisser pour compte. Ces projets vont leur permettre de réintégrer le tissu social et économique et de ne plus vivre de l’assistanat. Ce sont les projets solidaires qui au-delà de l’aspect économique, apporteront à nos compatriotes un réconfort moral certain.
Nous avons en matière d’infrastructures également un volet énergie, puisque l’eau et l’énergie sont, dirais-je, les deux faces d’une même pièce, l’un ne va pas sans l’autre ! Nous avons achevé avec succès l’interconnexion électrique par l’hydroélectricité avec l’Ethiopie. Dans le même temps nous avons un vaste programme d’énergie éolienne. Dans une première phase nous travaillons sur un programme de production de soixante mégawatts à partir de l’énergie éolienne avec deux entreprises françaises, Alstom et Valéco. Nous collaborons par ailleurs avec elles dans la recherche de financements pour mener à bien ces projets communs. Ceux-ci d’ailleurs avancent bien, puisque des discussions sont engagées avec la Proparco, une filiale de l’Agence française de développement (AFD). Cet investissement projeté est en quelque sorte un premier ballon d’essai pour notre pays dans le développement de cette énergie durable qu’est l’énergie éolienne, c’est la raison pour laquelle nous tient tant à cœur. Nous sommes confiants sur les capacités de cette énergie à se développer par la suite de manière exponentielle sur notre territoire, et ce d’autant plus que son essor s’inscrit dans la stratégie globale de renforcement de la résilience des populations de notre pays. Nous avons également un programme avec la Banque mondiale, à travers l’Agence djiboutienne de développement social (ADDS). Il a été conçu selon deux axes interdépendants, le premier vise à renforcer la consolidation des acquis en matière de développement social, et le second à développer des activités génératrices de revenus pour les poches les plus vulnérables de nos communautés. Comme vous le voyez, nous sommes en train de développer une série de programmes concomitants et imbriqués. Les trente-trois millions de dollars que vous évoquez ne représentent que la réponse à une situation d’urgence immédiate. Bien évidemment il y a un schéma directeur à long terme pour consolider la résilience de nos populations. Le chef de l’État, qui à participer tout récemment à New York à un mini-sommet sur la crise humanitaire dans la Corne de l’Afrique, a prononcé un discours très important, dans lequel il a pu énoncer les grandes lignes de ce programme. Vous comprendrez que sa mise en œuvre est fondamentale si nous souhaitons renforcer la résilience de nos populations.
Le ministère des Affaires étrangères, dont vous êtes à la tête, a diffusé un communiqué de presse peu ordinaire, lors de la reconnaissance officielle par notre pays du Conseil national de transition libyen (CNT), vous affirmiez dans celui-ci : « espéré avoir des relations meilleures avec les nouvelles autorités libyennes que celles qui ont pu exister par le passé avec le régime de Kadhafi ». Je suis un peu surpris il n’y a pas si longtemps que cela nous déroulions le tapis rouge à Djibouti au colonel Kadhafi ? Comment expliquer que nous ayons changé aussi rapidement de fusil d’épaule ? A quel moment nos relations se sont-elles détériorées avec le régime libyen ?
Je pense que nos relations avec la Libye ont été jugées normales jusqu’au déclenchement de la guerre que l’Érythrée nous a imposée. La Libye a clairement pris position contre la République de Djibouti à l’époque où le régime de Kadhafi était en place à Tripoli. Si vous vous rappelez, le 23 décembre 2009, lorsque la République de Djibouti, en coordination avec quelques membres du Conseil de sécurité issus de pays africains, a introduit un projet de résolution condamnant l’Érythrée pour son agression à l’encontre de Djibouti et l’occupation de son territoire. La Libye qui était à l’époque membre du Conseil de sécurité, a été le seul pays sur les quinze membres, je dis bien le seul, à voter contre ce projet de résolution. Cela a vraiment été un tournant dans les relations entre nos deux pays. Nous n’avions à l’époque pas compris et jusqu’à ce jour, nous n’expliquons pas comment un pays arabe qui est supposé défendre les intérêts des pays de la confédération arabe, prenne la décision de voter contre une résolution, qui va pourtant dans le sens des intérêts légitimes d’un autre pays de la communauté. Depuis, indéniablement je crois, les relations avec le régime de Kadhafi se sont détériorées et nous avons d’ailleurs exprimé de vive voix notre désaveu, notre désaccord par rapport à cette attitude de la Libye.
Par ailleurs nous avons également quelques soupçons que ce régime finançait un certain nombre d’actions de déstabilisation menées soit par des groupuscules extrémistes dans la région, voire même en appuyant financièrement des pays tel que l’Érythrée, qui pourtant n’hésite pas à s’ingérer dans les affaires intérieures de tous les pays de la région. Nous avons de fortes présomptions que la Libye de Kadhafi finançait ces activités. Djibouti n’a jamais retourné sa veste : nous somme un petit pays qui essaie de préserver de bonnes relations avec la plupart de ses partenaires et a priori, avec les pays arabes puisque Djibouti est un pays membre de cette Ligue. Je pense que le départ du régime de Kadhafi a déjà apporté une embellie en matière de sécurité dans la région de la Corne de l’Afrique. Prenons en exemple, le retrait des shebabs de Mogadiscio, c’est un signe qui ne trompe pas…
Monsieur le ministre, nous ne possédons ni pétrole ni gaz, et encore moins de minéraux rares, aussi on n’a un peu de mal à comprendre quelles sont les motivations sous-jacentes à la coopération chinoise pourtant très active sur notre sol ?
La Chine a depuis longtemps marqué sa présence sur tout le continent africain. Il ne s’agit pas uniquement d’exploiter les ressources d’un pays africain mais la Chine se positionne sur le marché africain comme un partenaire incontournable. La Chine est maintenant un grand pays dont l’industrialisation a atteint des niveaux records et qui a des ambitions extrêmement expansionnistes en matière commerciale. Et de cela elle ne s’en cache pas. La Chine doit écouler ses produits, chercher de nouveaux marchés et entretenir d’excellentes relations avec tous les pays africains pour pouvoir justement gagner ces marchés. Elle opère également à travers des sociétés de construction qui gagne des marchés importants sur le continent. C’est une plus-value pour notre pays et aujourd’hui il y a plusieurs sociétés chinoises qui sont depuis plusieurs années déjà, opérationnelles à Djibouti en matière de construction. Tout cela s’inscrit dans une stratégie du gouvernement chinois amorcée il y a plus de trois décennies, celle d’une ouverture de la Chine sur le monde. Vous avez entendu hier soir à la réception de l’ambassade de Chine, le discours de l’ambassadeur qui disait « qu’après une introspection, une fermeture sur soi-même de la Chine, nous menons depuis trois décennies une ouverture sur le monde » et cela implique des actions de ce type. Il ne faut pas s’étonner que la Chine entretienne des bonnes relations avec tous les pays africains et je crois que ce n’est pas seulement à sens unique. Si ce grand pays a de bonnes relations avec les pays africains, c’est également parce qu’il en tire des profits incontestables.
Le gouvernement vient d’annoncer le plus vaste mouvement d’ambassadeurs et d’ouverture d’ambassades qu’ait connu notre pays, aussi ma question est la suivante, avons-nous les moyens de nos ambitions ? Sommes-nous en mesure d’assumer un tel déploiement diplomatique ? Sur le même thème, je voudrais connaître votre sentiment quant à savoir si une corrélation existe entre, le montant de l’aide versé à un pays en voie de développement, et les appuis politiques attendus en retour par le pays donateur ? Et si oui, quels sont les atouts que peut se prévaloir notre pays dans cette realpolitik ?
Je crois que les deux sont liés, je pense que les relations internationales ne se limitent pas à l’aide publique au développement. Les relations internationales sont variées, la diplomatie agit sur plusieurs volets : il y a les investissements directs étrangers (IDE) qui rentrent dans le champ de compétences de la politique étrangère de la diplomatie djiboutienne. Il y a la mobilisation des ressources financières pour l’économie de notre pays qui rentre également dans le champ de compétence de notre diplomatie, il y a le rayonnement de manière générale de la République de Djibouti. En tant que petit pays, nous devons avoir beaucoup de visibilité sur la scène internationale, être présent dans les conférences internationales, être présent dans les forums internationaux, si nous souhaitons faire entendre la voix de Djibouti. Nous sommes un petit pays et nous devons user des moyens qui sont à notre disposition, pour pouvoir acquérir cette notoriété, cette influence et, l’installation de nouvelles ambassades à l’étranger s’inscrit dans cette logique qui vise à rehausser la visibilité de la République de Djibouti. Et, bien entendu, ce n’est pas de la représentation diplomatique pure et simple que nous attendons de nos chancelleries, nous voulons que nos ambassades deviennent réellement des instruments au service du développement de l’économie djiboutienne. Et, c’est à ce titre que le chef de l’État, a renouvelé en profondeur le corps diplomatique, en nommant de nouveaux acteurs de notre diplomatie. Par cette décision il a souhaité apporter du sang neuf, des idées nouvelles, et de la dynamique à la diplomatie djiboutienne. Il a décidé d’ouvrir de nouvelles ambassades dans des capitales importantes justement pour se donner les moyens de nos ambitions.
Lorsqu’on a des ambitions, l’ambition d’avoir cette visibilité et ce rayonnement, il faut s’en donner les moyens et ces moyens là, passent d’abord par cette présence dans ces capitales-là. Je pense également à cette jeunesse qui aujourd’hui, commence à prendre lentement mais sûrement les rênes et les commandes de la diplomatie djiboutienne, cette jeunesse dont on attend beaucoup… La moyenne d’âge des ambassadeurs récemment nommés est de 40 ans, vous imaginez donc l’importance que le chef de l’État accorde à la diplomatie djiboutienne dans le cadre de la politique de développement de notre pays.
Je crois aussi que c’est le résultat ou le fruit de notre politique d’ouverture et de rapprochement avec les pays influents. Nous abritons aujourd’hui les forces d’autodéfense japonaises à Djibouti, cela a demandé plusieurs années de travail, les Japonais ne sont pas venus par hasard. Ils sont actuellement installés en République de Djibouti, mais cela a commencé fin 2008 lorsque nous avons commencé à négocier cette présence. Nous avons essayé de mettre en place une relation stratégique, celle-ci a abouti, notamment avec l’arrivée de forces d’autodéfense japonaises qui sont là pour un certain temps. Bien entendu ce sont des forces d’autodéfense qui travaillent dans le cadre de la lutte contre la piraterie.
Comment expliquez-vous que l’aide annuelle au développement versée par le Japon à notre pays soit passée, entre 2006 et 2010, de 2 millions à 40 millions de dollars ?
Mais je vous le dis, ceci n’est pas un hasard si l’aide publique au développement accordée par le Japon à Djibouti a évolué vers plus de financements pour des projets de développement. Cette aide continuera dans les années à venir à se développer.
Pourriez-vous nous indiquer le montant que le Japon s’acquitte auprès du Trésor public au titre de l’occupation d’une base militaire sur notre territoire ?
Le Japon paie un loyer pour les infrastructures aéroportuaires et les facilités militaires.
Je n’ai pas de chiffres en tête mais ce n’est vraiment pas conséquent en comparaison avec l’aide publique au développement que nous octroie le Japon.
La question somalienne semble insoluble, pensez-vous réellement qu’un jour ce grand pays parviendra à relever la tête ? Et si oui, comment ?
La Somalie est un pays sinistré depuis maintenant deux décennies en raison de la guerre civile qui prévaut dans ce pays frère. Mais sachez que les derniers développements de la situation, notamment la signature de l’accord de Kampala, et la mise en place de la feuille de route qui sont à l’origine basés sur l’accord de Djibouti ont ravivé un certain espoir. Ces derniers rebondissements de la situation politique laissent augurer de bonnes perspectives pour la stabilisation de la Somalie. Il faut ajouter à cela l’affaiblissement des forces de destruction que représentent les shebabs qui ont quitté Mogadiscio et qui n’arrivent plus à se rebâtir ou à se reconstruire suite à la débâcle qui leur a été infligée dans la capitale somalienne. La période de transition a été prolongée d’un an avec un agenda très précis notamment en matière de rédaction et d’adoption de la Constitution, de réformes parlementaires, d’organisation d’élections, et ce d’ici le mois d’août prochain. Il y a quand même des pré requis ou des conditions qui ont été mises en place pour parvenir à la stabilisation définitive de la Somalie.
Il est envisagé par notre pays d’envoyer un contingent militaires rejoindre les forces de la coalition internationale de l’AMISOM [1], ne craigniez-vous pas qu’il puisse y avoir un risque important à s’impliquer autant dans cette crise somalienne à l’aune du lourd tribut payé par les forces de l’AMISOM, on parle de plusieurs centaines de morts à Mogadiscio, sans compter le fait que notre pays, en s’engageant dans cette voie, devient une cible de choix pour les extrémistes, l’exemple malheureux de l’Ouganda est là, pour en témoigner ?
Il faut préciser d’abord que la demande d’envoi des troupes djiboutiennes, dans le cadre de l’AMISOM, vient du gouvernement somalien, ensuite de la communauté africaine, à travers l’Union africaine et enfin de la Communauté internationale, qui ont vu les atouts dont disposent les forces djiboutiennes, des atouts qui pourraient contribuer à un meilleur succès de l’action des forces de l’AMISOM. Nous sommes un pays qui partage avec la Somalie une langue, une culture et certaines valeurs qui permettront aux forces djiboutiennes de pouvoir faire oeuvre utile sur la scène somalienne. Et cela nous a pris un peu plus d’un an pour pouvoir préparer adéquatement cette force militaire de maintien de la paix. Il s’agit concrètement d’un bataillon de 850 soldats qui a été appuyé à travers le programme ACOTA, qui est un programme développé par les Américains pour venir en assistance aux forces africaines projetées dans des missions de maintien de la paix sur le continent africain. Nous avons également l’appui d’instructeurs français qui préparent nos soldats pour le déploiement en Somalie dans le cadre de l’opération de l’AMISOM.
Bien entendu, il y a des risques lorsque l’on envoie des troupes en opération ; mais le fait que l’on s’abstienne d’envoyer des troupes ne nous garantit d’ailleurs pas une sécurité interne à toute épreuve. Le terrorisme est un fléau qui n’a pas de frontières, qui ne cherche pas d’excuses pour agir et attaquer là où les brèches existent, et nous savons que tout cela comporte un certain nombre de risques. Mais il faut savoir que la République de Djibouti s’est toujours positionnée sur le dossier somalien comme un partenaire recherchant la réconciliation, la paix et la stabilité pour ce pays. Cela est nécessaire pour Djibouti puisque nous sommes un pays voisin de la Somalie, et la stabilité de la Somalie contribue à consolider notre propre stabilité.
Ajouté à cela bien entendu, l’utilité que peut avoir le déploiement des forces djiboutiennes sur ce théâtre d’opérations. C’est d’abord un meilleur aguerrissement pour nos forces car elles vont acquérir sur un champ de bataille de l’expérience qui pourra à long terme, être utile pour la protection et la surveillance de notre propre territoire national. Je pense qu’il y aura beaucoup d’avantages à tirer de ce déploiement comportant bien entendu un certain nombre de risque. Il appartient aux pouvoirs publics, aux forces de sécurité nationale de pouvoir mesurer, jauger et juger de ses risques, et faire en sorte que les éléments terroristes qui seraient tentés de mener des opérations à Djibouti en soient dissuadés.
Pensez-vous que le président somalien Sharif Ahmed Sharif possède le charisme et l’autorité suffisante pour pouvoir imposer la « paix des braves » et conduire son pays vers la réconciliation et la paix ?
Je crois que le dossier somalien est très complexe. Si une quelconque personne dans le monde avait une solution ou la recette miracle, la Somalie aurait quitté cette zone de turbulence depuis longtemps. Ce qu’il faut savoir, c’est que le président Sharif, depuis les accords de Djibouti, a œuvré pour la réconciliation nationale. Il commence maintenant au bout de deux ans à récolter les fruits de ses efforts. Nous sommes très optimistes à Djibouti, nous pensons que cette période de transition supplémentaire de douze mois qui a été prolongée depuis le mois d’août dernier, sera une période cruciale, une période décisive et devra être soutenue activement par la communauté internationale.
Soutenons-nous l’accord de Kampala ?
Le président de la République l’a dit et répété à maintes reprises : oui nous soutenons la feuille de route qui a été mise en place suite à cet accord de Kampala qui, je le rappelle, émane de l’accord de Djibouti. Il n’y a pas de rupture par rapport au précédent accord puisque ce sont les mêmes institutions qui ont été créées à Djibouti, qui continuent à mener cette transition à son terme.
Comment expliquez-vous le décalage entre la position des États-Unis d’Amérique et celle de la grande majorité des États membres des Nations unies quant à la reconnaissance d’un État palestinien ? Comment expliquez-vous que l’« enfant gâté » du Proche-Orient puisse bafouer si ouvertement les différentes résolutions des Nations unies, dénier les droits élémentaires des Palestiniens, poursuivre la colonisation aussi bien en Cisjordanie qu’à Jérusalem-Est, envers et contre tout, et continuer irrémédiablement à bénéficier du soutien indéfectible des États-Unis d’Amérique ?
La position de Djibouti a été très claire sur cette question : le président de la République a, lors de son discours à la 66e session de l’Assemblée générale, réaffirmé les droits du peuple palestinien de disposer d’un État reconnu par tous les membres de l’ONU, c’est la position de Djibouti. Concernant la position des États-Unis d’Amérique ou bien encore de celle de l’Union européenne, me l’expliquer ou essayer de la justifier n’est pas de mon ressort. Je m’exprime uniquement au nom de la République de Djibouti, et Djibouti a exprimé sa position ferme, sur la question palestinienne. D’ailleurs celle-ci a été formulée à nouveau et très clairement ce matin même, à l’occasion de la 2e séance solennelle d’ouverture du Parlement, par le Premier ministre Dileita Mohamed Dileita dans son discours de politique générale. Il a mis le point, sur un certain nombre de principes de base pour le retour de la paix au Proche Orient, tel qu’un État palestinien, au côté d’un État d’Israël, dans ses frontières de 1967 et ayant Jérusalem-Est pour capitale. Le retour à la paix et à la sérénité au Proche Orient, n’a pas d’autre issue, que celle-ci ! A partir de là, le droit de chaque peuple à disposer d’un État reconnu, à part entière, est un droit inaliénable qui est prévu par la déclaration universelle des droits de l’homme et la charte des Nations unies. Le Sud-Soudan est le 194e État à être reconnu par les Nations unies. Nous espérons que la Palestine en sera le 195e.
Le gouvernement négocie les accords militaires avec la France, ceux-ci n’ont pas encore été signés, y aurait-il des difficultés à trouver un accord satisfaisant entre les deux parties ? Globalement l’effectif des troupes françaises va diminuer, est ce que cela implique que le montant de la contribution de la France pour le stationnement de ses forces serait susceptible d’être revu à la baisse ?
Depuis plusieurs mois, nous sommes entrés dans un long processus de négociation avec nos amis français sur cet accord de défense qui a plusieurs volets : militaire, sécuritaire et financier. Nous avons pratiquement bouclé la plupart des points saillants qui peuvent revêtir un caractère important. Il existe un ou deux points sur lesquels nous allons continuer de négocier. Le ministre de la Défense devrait se rendre le 12 octobre à Paris pour rencontrer son homologue pour pouvoir régler ces quelques points en suspens. La diminution des effectifs français à Djibouti ne devrait pas avoir un impact économique. Il s’agit de la Légion étrangère qui a quitté Djibouti où son impact n’était pas très important, comparée aux autres corps de l’armée française, comme le RIAOM.
Les difficultés que nous rencontrons ne sont pas dues à des divergences entre les deux parties mais à des agendas politiques des uns et des autres. Nous sommes entrées dans une phase de présélections, de campagnes électorales, d’élections présidentielles qui nous ont pris à peu près trois mois, ce qui a retardé la poursuite des négociations entre les deux parties. Nous allons essayer d’accélérer le processus pour éviter de tomber dans la phase préélectorale française car cela risque de décaler encore l’aboutissement de ces efforts [2].
Devant les difficultés rencontrées auprès des services consulaires français par nos concitoyens pour l’obtention d’un visa, que ceux-ci soient d’ailleurs, étudiants diplômés aspirant à poursuivre des études universitaires en Europe ou des personnes qui souhaitent tout simplement rendre visite à des proches, les questionnements sont nombreux quant au fait que le gouvernement djiboutien n’agisse pas davantage auprès des autorités françaises afin que les demandes de visa ne s’apparentent plus à un parcours du combattant ?
Nous sommes parfaitement conscients de cette situation et des frustrations qui peuvent naître de ces difficultés mais je veux être très clair sur ce point, la question de la délivrance de visa, est une question de souveraineté nationale… Il ne nous appartient pas de dicter les conditions de délivrance et encore moins d’imposer un quota minimum.
Ceci étant dit, dans le cadre de notre dialogue diplomatique avec les autorités françaises présentes à Djibouti, nous faisons un plaidoyer actif auprès de l’ambassade de France en sensibilisant nos partenaires à cette préoccupation majeure de notre population. Je me félicite d’ailleurs de constater que ces efforts commencent à porter leurs fruits puisque nous sentons quelques améliorations dans le nombre de visas délivrés.
Enfin, ne pensez-vous pas que vous avez fait le tour de la maison, n’ambitionnez-vous pas avec l’expérience qui est la vôtre, une carrière à la tête d’une importante organisation internationale, l’Union africaine par exemple ?
Le chef de l’État a jugé utile de me reconduire dans mes fonctions de ministre des Affaires étrangères, et j’essaierai d’être à la hauteur de cette confiance renouvelée et faire de mon mieux pour pouvoir apporter à mon pays mon expérience et un certain savoir-faire, en m’efforçant notamment de drainer un maximum de ressources. Quant à ma carrière future, il faut avancer pas à pas dans la vie, sans se presser ni devancer ce qui va arriver… Pour l’instant, je suis à cette étape de ma vie, et plus tard, inchallah on verra !
Propos recueillis par Mahdi A.
Les adresses courriel ne sont pas affichées.